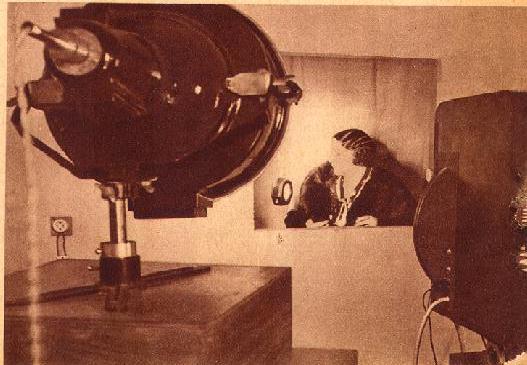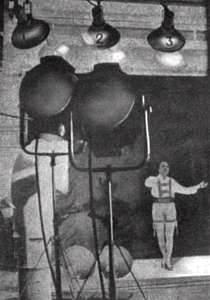SUITE
Environnement des premières émissions de télévision mécanique

Reconstitution du studio des PTT rue de Grenelle à Paris (1935).
On distingue la caméra mécanique (à droite) et les manches à air pour le refroidissement.
(Copyright Musée de Radio France. Photo Roger PICARD).
René BARTHELEMY utilisa deux techniques de prise de vue durant ses essais. La première, baptisée 'flying spot' par les anglais, fut
la plus utilisée pour les premiers essais à 30 lignes
entre 1928 et 1932. Elle consistait à balayer le sujet
plongé dans l'obscurité totale, d'un pinceau de
lumière intense. La lumière ainsi
réfléchie, était transmise aux
cellules
photo-électriques placées de part et d'autre devant le sujet.
Pour obtenir le pinceau de lumière, on plaçait une lampe
à arc dont la lumière était dirigée soit
sur le tambour à miroir, soit sur le disque de Nipkow analyseur,
selon le type de caméra utilisée. La lumière
passant successivement par chaque trous du disque, ou
réfléchie par chacun des miroirs du tambour,
éclairait le visage du sujet.
Compte-tenu de la faible sensibilité des cellules
photo-électriques, cette technique était la plus
performante à ce moment d'évolution de la technologie.
Elle présentait toutefois un énorme inconvénient:
il n'était guère possible de téléviser
autre chose qu'un sujet dans un cadre réduit, le plus
généralement le visage et le haut du buste d'une personne
!
La deuxième technique utilisait une caméra à disque de Nipkow
pour la
prise de vue en lumière diffuse.
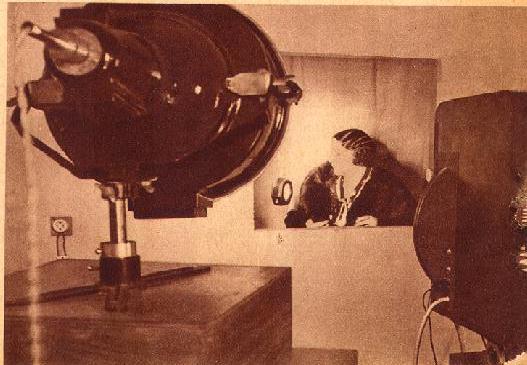
Cette fois, la scène ou le personnage a téléviser
était entièrement (et violemment) éclairé
et l'unique cellule photo-électrique placée
derrière le disque, recevait les impulsions de lumière
passant à travers les trous du disque.
Cette technique nécessitait une très grande
quantité de lumière: 15.000 lux pour le 60 lignes,
à cause du faible rendement des cellules
photo-électriques de l'époque et les pertes
considérables de lumière dûes au disque de Nipkow.
En conséquence et pour éviter de mettre en péril
la santé des acteurs/présentateurs, le studio devait
être équipé d'un système de refroidissement
efficace!.
Il est à noter que malgré cela, la température
ambiante du studio atteignait fréquemment les 45°
centigrades lors des premiers essais!
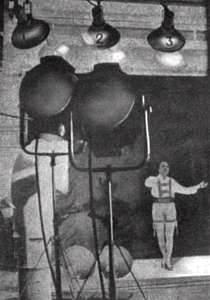
Scéance de prise de vue au studio des PTT en 1935.
Avec la mise au point des
premiers tubes photomultiplicateurs au gain élevé en 1936, on put remplacer les
cellules photo-électriques peu performantes et augmenter considérablement
la sensibilité des caméra mécaniques. Le tube
photomultiplicateur vint à la rescousse
du 180 lignes, qui exigea à ses débuts une
quantité de lumière phénoménale (48.000
watts!)
En raison de la faible sensibilité des cellules
photoélectriques des caméras, il fallut également
étudier un maquillage spécial afin de rehausser les
traits des acteurs : contour des yeux noir, fond de teint blanc et
ocre, lèvres noires etc. à l'instar des acteurs des
débuts du cinéma.
Au cours des toutes premières expériences de
télévision, la caméra et le sujet ne pouvaient se
déplacer. Lors des premières émissions officielles
des PTT, les caméras 60 lignes, puis 180 lignes, furent
placées derrière une vitre afin que le bruit du moteur
entraînant le disque ne soit transmis. Avec la prise de vue en
lumière diffuse, les scènes se composaient d'une, puis
deux à trois personnes se déplaçant dans
le champ étroit de la caméra.
Conditions de réception des premières émissions de télévision en 30 lignes
Les premières images télévisées étaient de
très basse définition:
24 à 60 lignes (comparez avec le nombre de lignes actuelles
(625).
Ces images, malgré le manque de détails qui les
caractérisaient (ce qui n'était pas uniquement lié
à la faible définition, mais aussi au rendement des
systèmes d'amplification électroniques), enchantaient les
premiers téléspectateurs ,émerveillés par
cette image petite (quelques centimètres), rougoyante, instable et tremblotante.
Pour voir et entendre une émission de télévision
à cette époque (1930), il fallait
généralement deux postes de radio en plus du
'téléviseur' proprement dit, lequel consistait en un
bâti comprenant le disque de Nipkow et son moteur
d'entraînement avec divers réglages de cadrage de l'image
et de vitesse du moteur, enfin la lampe néon et son support.
Sur les appareils 'perfectionnés', comme la version du constructeur allemand
TEKADE
vers 1932, on pouvait visionner soit le standard anglais Baird (image
balayée dans le sens vertical) ou français système
Barthélemy.(Image balayée dans le sens horizontal). Le
changement de standard se faisait en actionnant un levier
qui basculait la lampe néon sur l'une ou l'autre des spirales du disque. Il y avait donc,
deux fenêtres de vision et l'on regardait l'une ou l'autre selon que l'on captait Londres ou Paris.
L'un des postes de radio servait à capter le son de
l'émission de télévision et était
généralement utilisé par la radiodiffusion
ordinaire en dehors des
émissions expérimentales. Le deuxième
récepteur était également utilisé pour la
radiodiffusion en temps normal, puis aux heures voulues, une voix
annonçait que les émissions de 'Radiovision' allaient
commencer.
On donnait alors des instructions pour le réglage du 'téléviseur' et la mise en marche du moteur.
Puis la voix de l'annonceur était remplacée par un bruit
ressemblant au "vrombrissement d'un gros bourdon" (sic!),
caractéristique du bruit de l'image en 30 lignes. On savait
alors, que les émissions de radiovision étaient
commencées.
Il était donc temps de connecter la lampe néon du
'téléviseur' à la place du haut parleur du poste.
Venait ensuite le réglage acrobatique de l'image, qui, dans le
meilleur des cas se déplaçait continuellement de droite
à gauche.
Après plusieurs tentatives, les plus adroits
arrivaient à domestiquer l'appareil et pouvaient enfin voir les
images orangées, tremblotantes et floues du 30 lignes se
stabiliser (a peu près!) devant leur yeux
émerveillés.
A part les bustes des acteurs que pouvaient voir d'autre les premiers
téléspectateurs?
Le laboratoire de Télévision de la Compagnie des Compteurs de Montrouge,
avec à sa tête René Barthélemy, mis au point
assez rapidement un télécinéma.
Il fut donc possible de visionner des films
avec les téléviseurs mécaniques du début des années 30.
A l'émission, le télécinéma
était une machine de dimensions imposantes qui était
équipée d'un disque explorateur spécial munis de
trous sur une circonférence et 'découpant' les images du
film se déroulant en continu devant une fente étroite.
Au sujet de la couverture de ces émissions
expérimentales, il faut remarquer que grâce aux longueurs
d'ondes utilisés à l'époque pour transmettre les
images, il était souvent possible de recevoir en France les
émissions de la BBC de Londres. En outre, les émissions
expérimentales de la Tour Eiffel, étaient reçues
en province et jusque dans le midi.
Articles de magazines
Voir la suite de l'aventure de la Télévision
Page précédente